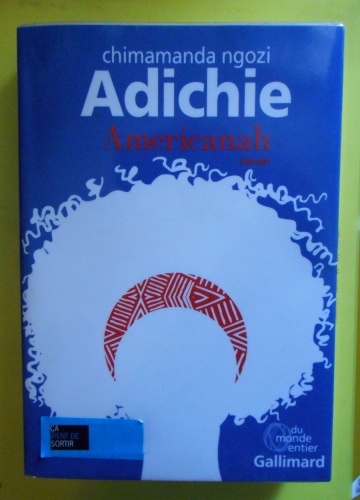L’observation des autres est souvent plus efficace que l’observation de soi-même : en tout cas en ce qui me concerne. J’adore regarder les autres, les passants inconnus autant que mes amis ou relations. Je regarde et j’imagine, j’extrapole, je déduis et parfois je comprends beaucoup de choses : sur moi-même. Lire, c’est un peu comme observer un autre de papier, non ?
L’an dernier j’ai lu Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie, j’ai observé son héroïne Ifemulu, et j’ai compris quelques petites choses sur moi. Miracle de mon nombrilisme.
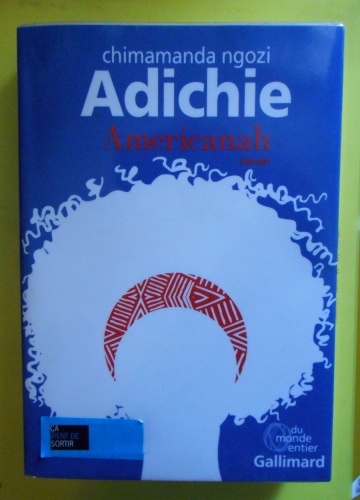
Ifemulu est une jeune nigériane qui part étudier aux Etats-Unis. Arrivée là-bas, elle se découvre noire, par le regard des autres et par la situation des Noirs Américains. De jeune fille de bonne famille, étudiante, ambitieuse, intelligente, elle devient « noire », comme un particularisme qui servirait à la définir tout entière. C’est cette redécouverte de sa race dans les yeux des autres qui est au centre du roman. Ifemulu ouvre un blog, pour partager ses observations de la vie américaine, du racisme, et des relations sociales. Comme un pied de nez à la vie, ce blog fera sa réputation et la conduira à tenir des conférences sur ces thèmes. Le lecteur, lui, observera la vie amoureuse et professionnelle d’Ifemulu évoluer, et se heurter aux préjugés raciaux, aux difficultés qu’engendre le fait d’être noir aux États-Unis. De la plus simple, à la plus grave. Ainsi, le livre s’ouvre dans un premier chapitre sur une scène dans un salon de coiffure pour cheveux afro, « dans cette partie de la ville pleine de graffitis, de bâtiments insalubres, sans un seul Blanc à l’horizon, ». Car c’est là qu’on exile l’africanité, et si une intellectuelle noire habitant à Princeton souhaite se faire tresser les cheveux, elle doit suivre le ban.
Être noir à Lagos et à Princeton c’est différent. Cette différence se chiffre par le nombre de rejets, d’exclusions, de sourires entendus, et de réflexions paternalistes quand elles ne sont pas ouvertement racistes.
Pour autant, pas d’atermoiements dans le roman de Chimamanda Ngozi Adichie, pas de sanglots, juste une fine observation factuelle, un recensement de la réalité de la peau noire, la liste des conséquences sur chaque instant de la vie, même le plus intime.
Cette observation dont Ifemulu est le point central, m’a forcément ramenée à moi, et à ma vie en France. À cette chose que peu de gens comprennent s’ils ne la vivent pas dans leur chair : le regard de l’autre qui fait de vous un étranger quoi qu’il arrive. J’ai souvent du mal à expliquer cela : je n’ai jamais vraiment souffert d’un racisme violent, au sens où je n’ai pas subit de « sale arabe », ou de « rentre chez toi » mais j’ai toujours eu droit à des remarques paternalistes, ou réductrices, dès lors que j’indiquais mon prénom. Des phrases comme « ça n’a pas été trop dur pour toi de poursuivre tes études ? » (Trop dur pourquoi ? parce que je suis censée venir d’une famille où on empêche les femmes d’étudier et où on les voile de force ? parce que génétiquement je serais vouée à l’illettrisme ?) Des phrases comme « Et tu rentres chez toi souvent ? » Quand je réponds oui, c’est à trois stations de métro, je comprends bien que mon interlocuteur situe mon « vrai » chez moi au-delà de la méditerranée et non sur la ligne du métro parisien.
Le racisme n’est pas forcément un coup de poing dans la face, il peut être un mot anodin, une question toute simple mais qui en dit long sur ce que l’Autre juge que l’on doit être : un éternel étranger, illégitime à vie.
La lecture de Americanah m’a renvoyé à ma propre situation et à la façon dont je la gérais. Une des raisons pour laquelle ce livre m’a bouleversée.
L’histoire d’Obinze, ancien amoureux d’Ifemulu, qui lui est arrivé à Londres, dans des conditions bien plus difficiles, est aussi passionnante à suivre. Les deux trajectoires des anciens amants finiront par se croiser à nouveau, chacun arrivant avec ses bagages et ses choix. L’histoire d’Ifemilu est aussi une belle observation d’un féministe quotidien, réel et vécu en prise avec un patriarcat aux habits multiples.
Je vous reparle de ce livre lu l’an dernier, parce que je l’avais beaucoup aimé à l’époque, que je n’avais pas eu le temps de le chroniquer, mais qu’il n’a guère quitté mon esprit. Et le fait est qu’il sort en poche ces jours-ci, alors n’hésitez pas à vous l’offrir ! Pour ma part, je l’avais emprunté à la bibli dès la sortie, et j’attendais le format poche avec hâte pour l’avoir chez moi (appartement parisien oblige, je privilégie toujours les formats poche..)
Bref, si vous ne l’avez pas encore lu, je vous y engage. Quelle que soit votre situation, vous y trouverez matière à réflexion.
Extraits:
« Ifemelu avait grandi dans l’ombre des cheveux de sa mère. Ils étaient noir-noir, si abondants qu’ils absorbaient deux flacons de démêlant quand on la coiffait, si épais qu’il leur fallait rester des heures entières sous le casque du séchoir, et quand enfin libérés des bigoudis de plastique rose ils s’échappaient en une masse libre et volumineuse, ils se répandaient jusqu’en bas de son dos comme une fête. Son père les appelait sa couronne de gloire. « Est-ce que ce sont de vrais cheveux ? » demandaient des inconnus qui tendaient la main pour les toucher avec respect. D’autres disaient : « Êtes-vous de la Jamaïque ? » comme si seul un sang étranger pouvait expliquer une chevelure aussi opulente qui ne s’éclaircissait pas aux tempes. Enfant, Ifemelu se regardait souvent dans la glace et tirait sur ses cheveux, les déroulait, souhaitant désespérément qu’ils deviennent semblables à ceux de sa mère, mais ils demeuraient rêches et poussaient difficilement ; les coiffeuses disaient qu’ils étaient coupants comme des couteaux. »
« Si vous dites que la race n’a jamais été un problème, c’est uniquement parce que vous souhaitez qu’il n’y ait pas de problème. Moi-même je ne me sentais pas noire, je ne suis devenue noire qu’en arrivant en Amérique. Quand vous êtes noire en Amérique et que vous tombez amoureuse d’un Blanc, la race ne compte pas tant que vous êtes seuls car il s’agit seulement de vous et de celui que vous aimez. Mais dès l’instant où vous mettez le pied dehors, la race compte. Seulement nous n’en parlons pas. Nous ne mentionnons même pas devant nos partenaires blancs les petites choses qui nous choquent et ce que nous voudrions qu’ils comprennent mieux, parce que nous craignons qu’ils jugent notre réaction exagérée ou nous trouvent trop sensibles. Et nous ne voulons pas les entendre dire : Regarde le chemin que nous avons parcouru, il y a seulement quarante ans nous n’aurions pu former un couple légal, bla-bla-bla, parce que savez-vous ce que nous pensons quand ils disent ça ? Nous pensons mais putain pourquoi cela aurait-il dû être illégal de toute façon ? Mais nous nous taisons. Nous laissons tout ça s’accumuler dans nos têtes et, quand nous assistons à de sympathiques dîners progressistes comme celui-ci, nous disons que la race n’est pas un problème parce que c’est ce que nous sommes censés dire, pour que nos sympathiques amis progressistes ne soient pas perturbés. C’est la vérité, je parle d’expérience. »