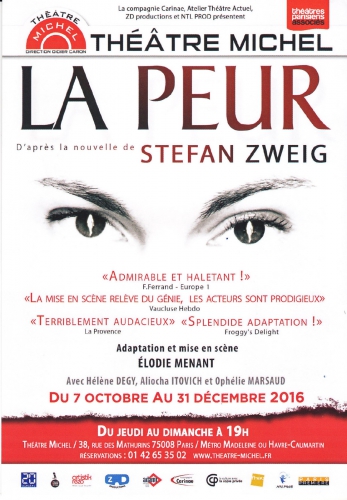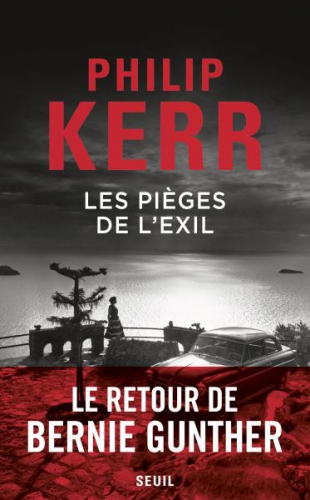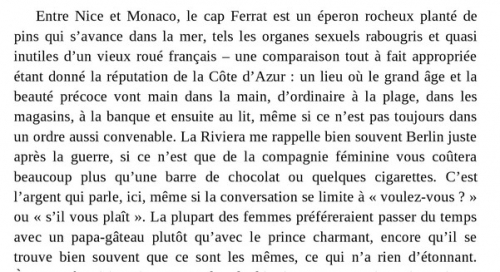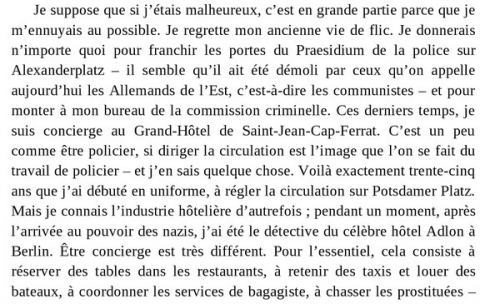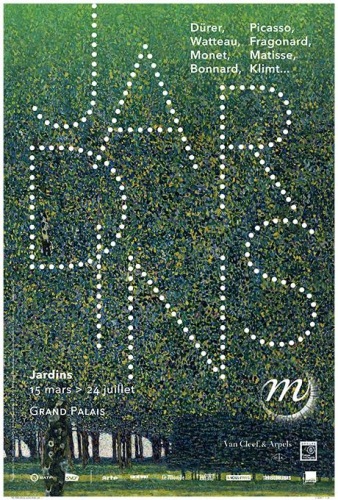C’est toujours intéressant de parler de soi, non ? Peu importe, considérez que je parle à voix haute. Le problème c’est que je pense trop, à des tas de choses inutiles, superflues, envahissantes, et inutiles surtout.
Autant les partager (tant pis pour vous, pauvres lecteurs perdus par ici).
Je n’ai jamais fait de banana bread. Je n’ai jamais de bananes assez mûres. Les fruits sont toujours mangés très vite chez moi.
Je pense souvent à Leonard Cohen en ce moment, à cause de sa chanson Who By Fire. Elle m’obsède un peu, genre depuis six mois, et là ça commence à faire long, je ne sais pas si je dois en parler à quelqu’un en particulier.
Je n’ai jamais mangé de banana bread. Pas encore eu l’occasion, et jamais croisé de boulangeries qui en vendent. En même temps je n’aime pas la banane cuite. Ceci explique cela ? Un évitement consciencieusement inconscient ?
J’ai trop de lubies à gérer en ce moment. C’est comme des petits parasites qui viennent, heu parasiter ? mes journées. Quoique j’exagère, je les gère tellement mieux qu’avant.
Exemple de lubies ? Tu ne veux pas vraiment savoir, mais moi je ne t’épargne pas. Je cultive mes obsessions, jalousement, comme autant de tares à laquelle je tiens précieusement.
J’ai la lubie des livres qui contiennent le mot Leviathan, alors je les lis tous, du moins j’essaie. Depuis le Leviathan de la Bible, au Leviathan de Paul Auster, en passant Par Thomas Hobbes ou Julien Green. Mon monde s’éclaire quand j’en découvre un nouveau à lire.
Je suis obsédée par les livres dont le titre contient American quelque chose. Même punition : je cours après les American Psycho, les American Pastoral, American Darling, American Rhapsody, et tous ceux qu’il me reste encore à lire.
Je devrais peut-être acheter des bananes, les laisser mûrir et faire ce fichu banana bread histoire d’évacuer le problème une fois pour toutes.
Je pense souvent à certaines actrices, elles ne sont pas mortes, si ce n’est pour le cinéma contemporain, qui les ignore complètement. Je pense souvent à Gabriel Anwar et à son parfait pas de danse avec Al Pacino dans Le Temps d’un Week-end. Je pense aussi souvent à Phoebe Cates, et aussi à Geneviève Bujold et Ali McGraw.
Tiens, elles sont toutes brunes. N’y voyez rien de définitif.
Je pense souvent que les paroles de Who By Fire sont exactement ce que je voudrais entendre en ce moment même, alors je l’écoute (merveille de l’internet, tu consommes instantanément tes désirs) (notez que je n’ai pas cédé au désir (brûlant) de faire un jeu de mots à base de désirs qui se consument dans le consumérisme (trop attendu) (mais tentant))))
Je crois que je relie cette envie de banana bread à quelqu’un qui en fait souvent et que j’aime bien, de loin. Je crois que je voudrais qu’elle me dise, viens, j’ai fait un banana bread, viens à la maison en goûter un morceau avec moi. (Je crois que je mets trop de sentimentalisme dans ce banana bread, je serais forcément déçue (c’est une sorte d’ostie, une communion avec quelqu’un que je ne mérite peut-être pas (il faut dire que je suis loin d’être l’amie idéale) (distante, timide, recluse dans un monde imaginaire))))
La dernière fois que j’ai ressenti l’assaut d’une lubie, c’était avec la couleur jaune. Il me fallait tout en jaune (une robe, un sac, un livre (n’importe quel livre avec une couverture jaune soleil suffisait à mon bonheur (pas reluisant pour une lectrice exigeante (ouais non, exigeante oui et non, je suis à géométrie variable, question exigence) une paire de chaussures, une broche, n’importe quoi de jaune m’emplissait de joie (je crois sincèrement que la couleur de la joie est le jaune)))))
Quand j’aime une chanson je peux l’écouter cent fois d’affilée : ce n’est pas une figure de style, je l’écoute cent, deux-cent fois, jusqu’à en gaver chacune de mes cellules, et même alors je ne m’en lasse pas, et il ne me reste plus qu’à pleurer d’incompréhension (parce que je ne comprends pas ce qui se passe, je suis juste effarée par ma propre obsession et par ce qu’elle peut cacher ou révéler (rien ? allez savoir))
Avez-vous parfois des révélations sur vous-même ? J’aime bien ce mot, révélation (tiens, cherchons voir s’il n’y a pas quelques dizaines de bouquins à lire contenant le mot Révélation) (nous voilà à nouveau au bord du gouffre du n’importe quoi) (enfin, nous, moi surtout, et évidemment je ne reculerai pas (je vous tiens au courant de la liste des livres « Révélation », si vous insistez)
Pardon mais j’en reviens à ce banana bread : comment m’en débarrasser ? Dois-je filer chez Starbuck en acheter un, l’engloutir et constater le goût amer de la déception ? Parce que forcément ce sera décevant, ce ne sera pas LE banana bread, ce plat qui mérite un cérémonial ne saurait être assimilé à ce truc vendu par une multinationale qui deal du sucre sous forme de café. Ça ne se peut.
Je me rends compte que la banane est un fruit jaune, comme le bonheur.