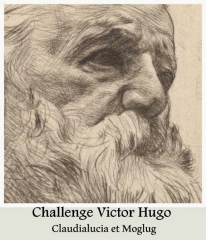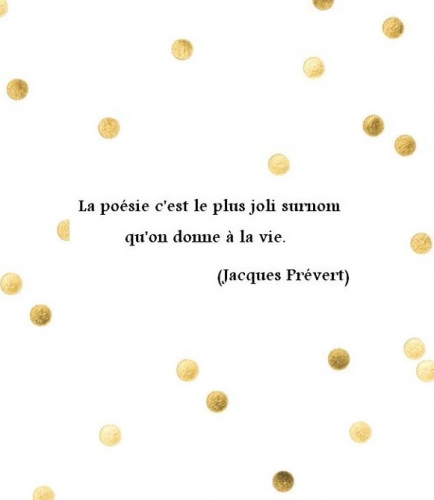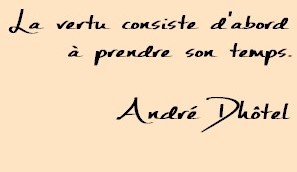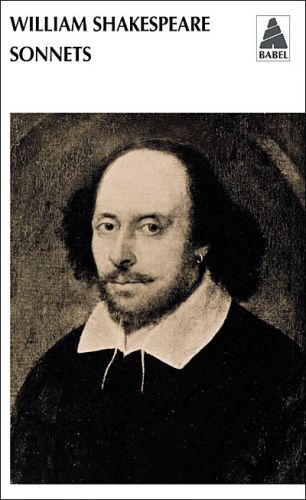Je profite du challenge Victor Hugo, initié par Claudialucia, pour partager avec vous un poème de Victor Hugo: Booz Endormi, tiré de l’incroyablement belle Légende des Siècles.
Il est particulier, ce poème. Bon, c'est Victor Hugo, donc forcément c'est géant et puissant, mais c'est aussi facétieux !
Et sinon, vous, tout va bien ?
Booz s'était couché de fatigue accablé ;
Il avait tout le jour travaillé dans son aire ;
Puis avait fait son lit à sa place ordinaire ;
Booz dormait auprès des boisseaux pleins de blé.
Ce vieillard possédait des champs de blés et d'orge ;
Il était, quoique riche, à la justice enclin ;
Il n'avait pas de fange en l'eau de son moulin ;
Il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge.
Sa barbe était d’argent comme un ruisseau d’avril.
Sa gerbe n’était point avare ni haineuse ;
Quand il voyait passer quelque pauvre glaneuse ;
« Laissez tomber exprès des épis, » disait-il.
Cet homme marchait pur loin des sentiers obliques,
Vêtu de probité candide et de lin blanc ;
Et, toujours du côté des pauvres ruisselant,
Ses sacs de grains semblaient des fontaines publiques.
Booz était bon maître et fidèle parent ;
Il était généreux, quoiqu’il fût économe ;
Les femmes regardaient Booz plus qu’un jeune homme,
Car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand.
Le vieillard, qui revient vers la source première,
Entre aux jours éternels et sort des jours changeants ;
Et l’on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens.
Mais dans l’œil du vieillard on voit de la lumière.
Près des meules, qu’on eût prises pour des décombres,
Les moissonneurs couchés faisaient des groupes sombres ;
Et ceci se passait dans des temps très-anciens.
Les tribus d’Israël avaient pour chef un juge ;
La terre, où l’homme errait sous la tente, inquiet
Des empreintes de pieds de géants qu’il voyait,
Était encor mouillée et molle du déluge.
Et ce songe était tel, que Booz vit un chêne
Qui, sorti de son ventre, allait jusqu’au ciel bleu ;
Une race y montait comme une longue chaîne ;
Un roi chantait en bas, en haut mourait un Dieu.
Et Booz murmurait avec la voix de l’âme
« Comment se pourrait-il que de moi ceci vînt ?
Le chiffre de mes ans a passé quatre-vingt.
Et je n’ai pas de fils, et je n’ai plus de femme.
» Voilà longtemps que celle avec qui j’ai dormi,
Ô Seigneur ! a quitté ma couche pour la vôtre ;
Et nous sommes encor tout mêlés l’un à l’autre,
Elle à demi vivante et moi mort à demi.
» Une race naîtrait de moi ! Comment le croire ?
Comment se pourrait-il que j’eusse des enfants ?
Quand on est jeune, on a des matins triomphants ;
Le jour sort de la nuit comme d’une victoire ;
» Mais, vieux, on tremble ainsi qu’à l’hiver le bouleau ;
Je suis veuf, je suis seul, et sur moi le soir tombe.
Et je courbe, ô mon Dieu ! mon âme vers la tombe,
Comme un bœuf ayant soif penche son front vers l’eau. »
Ainsi parlait Booz dans le rêve et l’extase.
Tournant vers Dieu ses yeux par le sommeil noyés ;
Le cèdre ne sent pas une rose à sa base,
Et lui ne sentait pas une femme à ses pieds.
Booz ne savait point qu’une femme était là.
Et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d’elle.
Un frais parfum sortait des touffes d’asphodèle ;
Les souffles de la nuit flottaient sur Galgala.
L’ombre était nuptiale, auguste et solennelle ;
Les anges y volaient sans doute obscurément.
Car on voyait passer dans la nuit, par moment,
Quelque chose de bleu qui paraissait une aile.
La respiration de Booz qui dormait,
Se mêlait au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse.
On était dans le mois où la nature est douce,
Les collines ayant des lys sur leur sommet.
Ruth songeait et Booz dormait ; l’herbe était noire ;
Les grelots des troupeaux palpitaient vaguement ;
Une immense bonté tombait du firmament ;
C’était l’heure tranquille où les lions vont boire.
Tout reposait dans Ur et dans Jérimadeth ;
Les astres émaillaient le ciel profond et sombre ;
Le croissant fin et clair parmi ces fleurs de l’ombre
Brillait à l’occident, et Ruth se demandait,
Immobile, ouvrant l’œil à moitié sous ses voiles,
Quel dieu, quel moissonneur de l’éternel été,
Avait, en s’en allant, négligemment jeté
Cette faucille d’or dans le champ des étoiles.